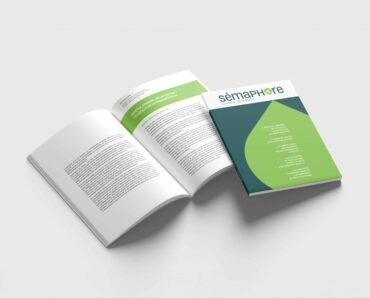Les thématiques abordées :
Répéter, réparer, ré-inventer : les enjeux de la transmission
Auteurs :
- Béatrice Boussard
Extrait libre d’accès
Un système, qu’il soit familial ou institutionnel, s’organise, fonctionne, évolue et transmet. Ce sont ses caractéristiques essentielles. La fonction de transmettre lui permet d’avoir une existence infinie. La transmission est au service d’un système ; elle protège son patrimoine.
Transmettre et hériter sont des fonctions incontournables que chaque membre d’un système doit assumer individuellement et collectivement. Quand on appartient à un système, au nom de sa survie, on ne peut pas ne pas hériter et transmettre. C’est une question existentielle : à qui, quoi et comment transmettre ? De qui, de quoi, et à quelle condition hériter ? Ce double mouvement s’opère de manière circulaire dans les liens (appartenance à une histoire) et les relations (ici et maintenant).
Force est de constater que nous ne sommes pas libres de nous-mêmes car dès que nous sommes saisis d’un sentiment d’appartenance à un système, nous nous trouvons saisis dans une histoire, celle des générations passées. L’héritage constitue un point de repère dans nos choix. La relation que nous avons avec nos « ancêtres », soit en direct, soit par la mémoire, nous permet de nous définir par rapport à eux et de nous situer dans le monde par rapport aux autres. Si nous n’avions point d’héritage, nous n’aurions aucun repère. La première idéologie deviendrait alors notre bouée de sauvetage. Transmettre est une façon de préserver les intérêts du futur.
La transmission demeure une évidence sans pour autant que l’on puisse en saisir la complexité du processus. On constate ses réussites, ses échecs. On identifie comment elle traverse les individus et surtout leurs relations. Dans cet article, la transmission est définie comme un processus émergent entre deux protagonistes (individu ou système), l’un étant identifié comme donateur, l’autre comme donataire – dans un contexte donné. Plus qu’une transaction, c’est une interaction qui a ses propres caractéristiques et ses règles subtiles. Elle consiste à donner à celui qui reconnaît au donateur, la légitimité de donner et de recevoir ce que le donataire peut lui rendre.
La transmission invoque le principe de réciprocité, la logique du don et contre-don.
RÉPÉTER, RÉPARER, RÉ-INVENTER…
Thérèse, ma mère, n’aimait pas son prénom, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais jamais au grand jamais, elle ne l’aurait avoué. Il lui avait été donné par sa mère adorée. La culpabilité était une compagne de longue date dans sa vie qui probablement existait avant elle. Elle se rappelait à elle au travers de tout ce qu’elle pouvait ressentir, penser, faire. C’était une prison psychique qui la condamnait au silence.
« Thérèse » lui avait été donné car sa marraine s’appelait Marie-Thérèse. Celle-ci était une enfant illégitime, reconnue lors du mariage de sa mère avec un homme qui « avait bien voulu la ramasser ». Voilà ce qui se disait de ces filles qui tombaient enceintes hors mariage, début du 20e siècle, dans les campagnes, et qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se marier avec le père de l’enfant.
La mère de Marie-Thérèse se prénommait Thérèse. Elle était elle-même issue d’une relation « inavouable » d’une des sœurs de ma grand-mère avec un père dit inconnu. En effet dans la famille d’origine de ma grand-mère, ses deux sœurs aînées étaient désignées comme « filles-mères » avec toute la connotation immorale que l’on puisse imaginer. Aussi, quand mon grand-père de 24 ans demanda en mariage ma grand-mère âgée alors de 18 ans, les parents s’empressèrent de répondre par l’affirmative. N’en demeure pas moins que toute la famille vivait dans la honte et le secret de ces pères non identifiables.
Ma mère incarnait en personne la honte. Annoncer une grossesse était honteux car supposait de fait une relation sexuelle. Ses sœurs et elle avaient été élevées dans la crainte de la sexualité qui ne pouvait que suggérer la transgression. Et les agissements de leur père et de leurs frères corroboraient cette construction. Les femmes de ma lignée maternelle devaient se montrer parfaites en tout point, c’est-à-dire : une mère au foyer, propre, douée pour la cuisine, élégamment habillée (en robe !), élevant ses enfants dans un savoir-vivre irréprochable, soumise à l’homme, respecté et pourvoyeur de salaire. En effet, le divorce était banni et il se disait que « la chèvre devait brouter là où elle était attachée ».
L’humour comme outil d’intervention
Auteurs :
- Catherine Gadby-Massart
- Fabrice Epaud
Extrait libre d’accès
Dans le champ des relations d’accompagnement, les émotions peuvent être permises, mais c’est rarement la joie qui est mise en avant. Que ce soit la joie pour la personne accompagnée ou la joie pour l’intervenant. Il est vrai que les personnes qui demandent de l’aide, le font souvent parce qu’elles sont dans la douleur et la souffrance. À première vue, il parait donc adapté que la joie ne soit pas la première émotion qui émerge dans tout ce qui peut se vivre à ce moment-là. Aussi, dans cet article, nous vous proposons tout d’abord de voyager dans les territoires émotionnels de tout humain.
Ensuite, nous regardons comment l’humour, qui participe grandement à la joie, émerge quelque fois spontanément dans un accompagnement. Quel intervenant n’a jamais eu un trait d’humour, une pensée humoristique ? Qui n’a jamais ri avec les personnes accompagnées ? Qui ne s’est pas senti puissamment relié à l’autre par un éclat de rire commun ? Qui n’a jamais pensé ou constaté que l’humour était un formidable allié dans le travail ?
Alors, nous nous autorisons à penser « l’humour comme outil d’intervention ». Nous vous invitons même à faire un détour par les apprentissages familiaux qui viennent parler de l’humour que nous pratiquons. Puis, nous nous appuyons sur notre posture systémique pour regarder les définitions de l’humour et en faire un outil d’intervention. Ainsi la relation, le contexte et la communication nous aident à bâtir un véritable outil utile aux intervenants et aux personnes accompagnées. Nous parlons également des processus d’intervention et de l’intensité qui s’y rattachent. Enfin, nous imaginons que l’humour ne devient un outil d’intervention qu’en présence de révélateurs que nous nous faisons une joie de vous présenter. Dans une intervention, si l’humour se présente, accueillons le pour ce qu’il est et si cela fait sens prenons le pari d’en faire un outil !
Introduction
Lorsque nous entrons dans la salle, la famille fait rapidement silence. On devine que notre venue met fin à une conversation animée entre le jeune et ses parents. Le plus jeune garçon est assis sur le tapis et joue sur la table basse avec deux playmobils. Les intervenants serrent la main de chacun en se prénommant.
La maman : Pardon de vous demander déjà ça… mon fils est inquiet ; il a un rendez-vous à son club de tennis à 18h et il craint de ne pouvoir arriver à l’heure.
Béatrice regarde sa montre :
Béatrice : Il est 16h15 et nous avons besoin de 1h15. Ton club est très éloigné ?
Lino : Il faut compter 20 minutes en tram.
Le papa : Le rendez-vous est plus important… Tant pis pour ton tennis. Nous faisons tous des efforts pour être là… Ton frère loupe l’école et nous avons dû prendre une après-midi… Alors ton tennis !!!
À ce moment, le ton monte fortement entre le père et le fils. Le fils argumente l’importance de son sport :
Lino : Je me suis engagé à organiser le tournoi du club dans un mois… Vous m’avez toujours dit qu’il fallait être à la hauteur de ses engagements. Il y a réunion et je dois y être…
La maman : Est-ce possible de raccourcir la séance ?
Damien s’approche de l’autre enfant avec une caisse de jeux et la pose près de la table basse au centre de la pièce.
Damien : Tiens, peut-être trouveras-tu quelque chose qui peut t‘intéresser !
Après avoir dit merci, le garçon se lance dans l’exploration de la caisse.
Lino : C’est bon, je rate mon tennis puisque tu y tiens à ton rendez-vous… Mais vous pouvez toujours courir, moi, je dirais rien !!!
Béatrice indique que le dernier quart d’heure sert souvent pour prendre rendez-vous.
Nous ne savons pas encore si nous serons amenés à nous revoir. Si c’est le cas – et si c’est correct pour toi et tes parents –, tu pourras t’éclipser pour prendre le tram.
L’adolescent regarde le sol sans rien dire.
Les personnes s’installent.
La compétence régulatrice des responsables d’équipe
Auteurs :
- Catherine Gadby-Massart
- Thierry Leblond
Extrait libre d’accès
L’utilisation en thérapie de la métaphore de « l’Enfant Intérieur » n’est pas une pratique nouvelle et a souvent été décrite par différents cliniciens. La plupart des écrits qui témoignent de cette pratique la situe principalement dans le cadre de thérapies individuelles. « L’Enfant Intérieur » est une métaphore pour parler de tout ce qui relie l’adulte à son enfance en matière d’apprentissages émotionnels et relationnels. Notre article porte plus spécifiquement sur l’utilisation de cet outil dans un cadre plus large incluant également les couples et les familles. À partir d’une lecture systémique, nous essayons de montrer en quoi « l’Enfant Intérieur » n’est pas en relation uniquement avec l’adulte qu’il est devenu mais également de façon indirecte comment il est en relation avec les autres membres de la famille et « l’Enfant Intérieur » porté par chacun d’entre eux.
À partir de vignettes cliniques, nous présenterons comment nous utilisons cet « Enfant Intérieur » de manière systémique et métaphorique, comme un outil thérapeutique et un levier de changement mais aussi comme un précieux collaborateur. Si l’« Enfant Intérieur » peut être au cœur des relations familiales, alors il peut être aussi au cœur de l’intervention.
1 – DE QUOI PARLE-T-ON ?
Qui n’a jamais vécu une situation qui le ramène à son enfance, voire même à sa petite enfance ? Notre mémoire sensorielle et émotionnelle accumulée depuis notre enfance est souvent réactivée dans notre présent. Nous en sommes parfois conscients lorsque par exemple l’odeur d’un gâteau ou la saveur d’un riz au lait nous font revivre des scènes de notre enfance. Des sensations agréables associées à des émotions de plaisir nous envahissent et nous voilà replongés dans le passé. Des souvenirs bien précis apparaissent et remontent à notre conscience. Nous relions alors le présent vécu dans « l’ici et maintenant » à notre vécu d’enfant. Celui-ci se réveille donc de temps en temps au contact d’une sensation, d’un vécu, d’une rencontre. Il est donc là présent en chacun d’entre nous. Il nous aide ou il nous empêche. Son réveil nous rend heureux quand il nous donne de véritables atouts pour développer notre capacité à jouer ou à être inventif. Son réveil nous rend aussi malheureux, quand il nous inhibe, quand la honte ressurgit, amplifiée au travers d’un événement de notre vie d’adulte ou quand une colère démesurée et incontrôlable explose. Ainsi, il sait se rappeler à nous de temps en temps. Dans notre clinique de thérapeutes systémiques, nous allons souvent chercher au fil des séances ces vécus d’enfants que nous rattachons aux situations présentes. En thérapie familiale, de couple, ou individuelle, nous utilisons les « Enfants Intérieurs » de nos patients pour en faire des leviers thérapeutiques. La notion d’ « Enfant Intérieur » n’est pas nouvelle et est utilisée dans différentes approches comme par exemple en hypnose Ericksonienne, en PNL, ou en analyse transactionnelle.
Pour ce qui est de notre pratique de systémiciens, après avoir défini ce que nous entendons par « Enfant Intérieur », nous nous attacherons à décrire à partir de différentes situations cliniques comment nous utilisons cet outil analogique spécifique.
En effet, nos interventions ne sont pas centrées sur les dimensions intrapsychiques, ni même uniquement sur la personne, mais bien en référence avec notre modèle systémique, c’est-à-dire en connectant « l’Enfant Intérieur » aux relations qu’il entretient aujourd’hui dans ses différents systèmes d’appartenance.
Nous utilisons souvent « l’Enfant Intérieur » d’une ou plusieurs personnes présentes en séance. Nous explorons ensemble son influence sur l’ensemble des relations familiales ou de couple. Nous vous proposons donc de faire avec nous ce voyage si particulier avec nos enfants intérieurs : ceux des usagers et ceux des intervenants. Nous vous invitons à partager notre pratique systémique avec ces précieux «collaborateurs».
La dictature de l’autonomie comme source d’épuisement familial
Auteurs :
- Jean-Luc Bay
Extrait libre d’accès
De nombreux professionnels de l’action sociale sont amenés à accompagner des usagers, des couples et des familles dans leur gestion économique et budgétaire.
Leurs outils habituels limitent cependant leur champ d’intervention, bien souvent à la seule dimension économique. C’est pour répondre à leurs besoins et inspiré par les possibilités d’ouverture nouvelles qu’offre le modèle systémique que nous leur proposons un outil nouveau : le budget analogique. Cet outil a pour but de permettre aux intervenants de revisiter le projet de la personne sous l’angle de ses propres choix, d’en clarifier les objectifs, de mobiliser les ressources et les compétences qui lui permettront de les atteindre. L’intervention comprend ainsi quatre étapes d’accompagnement progressif guidé par une éthique de la responsabilité.
Les gens ne veulent pas de travail, de l’argent leur suffirait
Coluche (Philosophe éclairé)
1 – BUDGET
L’évocation même du mot « budget » fait émerger immédiatement des listes de chiffres, des tableaux et autres diagrammes censés représenter une réalité financière plus ou moins équilibrée et qui reflète bien souvent une préoccupation quant à la gestion des ressources, sans parler de ce fameux « reste à vivre » qui en fait frémir plus d’un. Un sujet pour le moins anxiogène par ces temps de crise qui pourtant a le mérite de recouvrir des dimensions insoupçonnées pour peu que l’on questionne, moins son aspect économique (équilibres financiers), que sa dimension écologique (équilibres relationnels).
Au cours de mes réflexions concernant l’argent comme métaphore de la relation et dans l’héritage de pensées que m’a transmis Paul Segalen, le concept de budget analogique restait pour moi à préciser et enrichir. De là, et partant de ma sensibilité aux approches orientées compétences dans lesquelles le travail de l’objectif tient une place de choix, je me suis ainsi interrogé sur un outil très concret utilisable par les travailleurs sociaux qui accompagnent ces questions budgétaires et les arbitrages qu’elles impliquent. Dans sa version métaphorique, la classe des coûts et bénéfices que l’on trouve traditionnellement dans tout budget gagne à s’élargir au contexte relationnel. Cette approche vise à redynamiser le travail traditionnel du budget en l’augmentant d’une dimension systémique.
L’objectif de cet outil est double :
- permettre au travailleur social d’approcher les grandes lignes de ce que l’on appelle l’homéostasie familiale.
- permettre à la famille de réajuster ses choix de vie sur la base des éléments de son budget.
C’est lors d’une formation sur Brest auprès d’un groupe de travailleurs sociaux, mandataires judiciaires et CESF pour la plupart qu’a émergé cet outil. À l’évocation d’une possibilité de travailler le budget de manière plus analogique qui prendrait davantage en compte la dimension des choix, l’une des participantes m’avoua sa frustration de ne pas avoir d’outils plus précis et abouti. Nous nous sommes dès lors attelés à combler cette lacune avec un outil opératoire pour accompagner une ou plusieurs personnes sur la base d’éléments très concrets de leur budget quotidien. Nous nous sommes vite rendu compte qu’il dépassait largement le cadre du budget lui-même et permettait d’approcher tout changement, ou projet de changement, dans le cadre de vie d’une personne ou d’une famille.
La fonction thérapeutique de l’intervenant en relation d’aide
Antoine de Saint-Moi
Auteurs :
- Fabrice Epaud
Extrait libre d’accès
La confrontation à de la communication paradoxale, des injonctions paradoxales ou encore des doubles contraintes peut s’avérer difficile pour les intervenants. Elle peut générer le sentiment de tourner en rond et peut aboutir, pour le professionnel à la perte du sentiment de compétence ou au rejet de la famille ou de l’usager et de ses demandes paradoxales. Dans ce contexte, il semble important de se pencher sur la perception qu’a l’intervenant de la situation porteuse de paradoxes. Les neurosciences ont montré que nous percevions la réalité qui nous entoure selon deux processus différents. Nous avons d’un côté une approche analytique basée sur le digital et de l’autre une approche basée sur les analogies : « ceci ressemble à cela ». Une approche analytique de la réalité nous permet de comprendre les paradoxes, de les reconnaître comme tels et d’en saisir le fonctionnement. Mais une telle compréhension ne nous donne aucune indication pour les dépasser. Il est même possible que la perception d’une situation comme paradoxale favorise le désengagement du professionnel : plus nous sommes en capacité à percevoir les paradoxes, plus nous risquons de nous en échapper, laissant les familles se débrouiller avec leurs demandes impossibles à satisfaire. Une approche par analogie présente un cadre différent. Elle ne permet pas de repérer les paradoxes ou d’en saisir le fonctionnement, mais elle permet des recadrages susceptibles de les dépasser.
Dans cet article, l’auteur tente d’appréhender les paradoxes selon ces deux approches : une approche pour comprendre, une approche pour aider à recadrer les paradoxes dans une stratégie d’intervention.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’histoire du petit prince, voici ce qui se passe au début : Suite à une panne, un aviateur a dû se poser dans le désert. Il doit démonter son moteur et le réparer avant d’épuiser ses réserves d’eau et mourir de soif. C’est alors qu’il voit arriver, de nulle part, un enfant, plus exactement un petit prince, qui lui demande : « S’il vous plaît… dessine-moi un mouton… ». Pressé de reprendre ses réparations l’aviateur s’exécute mais aucun des moutons qu’il dessine ne convient au petit prince : « trop vieux », « trop malade »… Exaspéré et toujours pressé de reprendre son travail l’aviateur dessine une caisse et dit : « Ça c’est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » Et là, le petit prince sourit, il est satisfait et dit « c’est tout à fait comme ça que je le voulais ».
Il arrive souvent aux intervenants d’être face aux familles, comme l’aviateur face au petit prince. Une demande est faite, l’intervenant y répond mais cela ne convient jamais. De là peut naître une certaine usure, un sentiment d’incompétence, un certain agacement pouvant aller jusqu’au rejet de l’autre, devenu bien encombrant avec ses demandes jamais satisfaites. À première vue, la demande du petit prince n’est pas paradoxale. Au plus, elle peut être perçue comme déroutante, étant donné le contexte et l’utilisation dans la même phrase du vouvoiement et du tutoiement. Les interactions suivantes vont nous montrer que le petit prince ne veut pas le dessin de n’importe quel mouton, non il veut un mouton précis qui, sans doute, n’existe que dans sa tête. Du coup, le mouton désiré n’existant que dans la tête du petit prince, l’aviateur se retrouve face à une injonction paradoxale que l’on pourrait formuler ainsi : « S’il vous plaît, dessine-moi le mouton précis qui n’existe que dans ma tête à laquelle tu n’as pas accès ». À moins d’un coup de chance extraordinaire, l’aviateur pourrait bien dessiner des centaines de moutons sans pour autant dessiner celui qui convient au petit prince. Mais par chance, l’aviateur maîtrise totalement la théorie des niveaux d’apprentissages de Gregory Bateson et il propose un magnifique recadrage c’est-à-dire un changement de niveau permettant de sortir du paradoxe. Dans le problème posé par le petit prince, le dessin doit venir de l’aviateur, mais l’image du mouton ne peut venir que du petit prince qui en a une conception précise dans la tête. Le dessin accompagné par ce commentaire : « Ça c’est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » répond parfaitement à ce double impératif. Le dessin de la caisse est fait par l’aviateur et le mouton imaginé par le petit prince trouve sa place dans le dessin.