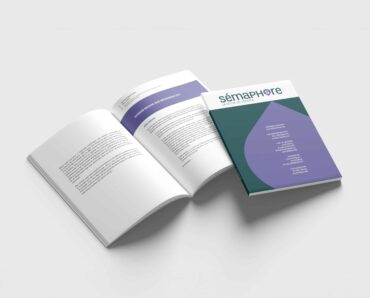Les thématiques abordées :
Donner raison aux résonances
Auteurs :
- Catherine Gadby-Massart
- Fabrice Epaud
Extrait libre d’accès
Depuis notre formation à l’approche systémique, nous sommes accompagnés de ces histoires de résonance. Nous n’avons pas toujours su quoi en faire ni comment cela pouvait être vraiment utile. En effet, souvent les résonances sont perçues comme un problème. Nous avons aussi pu regarder les résonances comme notre propriété, oubliant la part de la personne en face de nous. Dans notre pratique, nous avons fait l’expérience que les résonances émergeaient dans un système et dans des relations. Elles pouvaient alors devenir de véritables leviers de changement. Aussi, c’est le fruit de ce cheminement que vous retrouverez dans cet article : les résonances limites et ressources.Pour ce faire, nous avons construit une histoire en nous référant aux expériences vécues et racontées par des professionnels. Ceux-ci nous ont fait confiance en acceptant de partager avec nous des expériences de résonances vécues. Ce qui va suivre est fictif mais construit à partir de nos rencontres de formateurs et également, de notre expérience d’anciens travailleurs sociaux.
AVANT-PROPOS
Vous avez entre les mains un article que nous avons eu beaucoup de plaisir à écrire.
Nous souhaitons que vous ayez également plaisir à le lire. Pour ce faire, nous vous proposons de choisir entre deux façons différentes d’aborder la lecture qui va suivre.
- Vous pouvez l’aborder comme n’importe quel article, c’est-à-dire le lire avec votre tête : être plus ou moins intéressé par son contenu, être plus ou moins d’accord, le trouver plus ou moins utile à votre pratique…
- Vous pouvez également l’aborder différemment, comme une expérience complexe dans laquelle interviendra, en plus de votre tête, votre cœur (c’est-à-dire vos émotions) et peut-être même votre corps. Pour cela, nous vous invitons à lire cet article en vous intéressant à ce qui se passe pour vous d’un point de vue émotionnel, comment l’histoire relatée vous touche-t-elle ? Comment les différents personnages évoqués suscitent chez vous colère, tristesse, joie, peur, étonnement, dégoût ou même rien du tout ? Si un ressenti émerge de manière significative, nous vous invitons alors à utiliser la grille proposée en annexe pour vous aider à faire émerger ce qui fait résonance entre vous et l’histoire relatée.
- Bien entendu, il y a aussi une troisième façon d’aborder cet article : vous pouvez cumuler les deux approches. Dans ce cas, nous vous suggérons de commencer par la seconde.
Bonne lecture…
Reconsidération de l’approche fonctionnelle
Auteurs :
- Damien Légère
Extrait libre d’accès
En janvier 1991 dans la revue Résonance, Paul Watzlawick avait cette prédiction : « Je ne voudrais pas que l’on croie que ce que je pense est la vérité ultime. Je suis convaincu que d’ici quinze ans, les gens qui liront cet entretien, riront parce qu’alors notre champ sera tellement plus loin. […] Nous arriverons à un point où grâce à la cybernétique de second ordre (…) nous pourrons formaliser des choses qui n’ont jamais été formalisées auparavant.» Comme les pionniers de la thérapie familiale, il ne nous lègue pas un héritage figé les mettant en valeur mais un héritage vivant mettant l’humain en valeur. Dans cette perspective, l’équipe de Forsyfa a entrepris de reconsidérer chaque approche systémique : cerner les concepts fondateurs pour en définir le sens, clarifier une méthodologie d’appréhension spécifique. Après l’approche structurale, nous nous sommes mis au travail concernant l’approche fonctionnelle. Parler de fonctionnement nous amène dans le cœur même des systèmes : comment il émerge de l’interconnexion des éléments entre eux et comment il n’est pas un état mais un mouvement permanent. À travers un exemple pris dans notre clinique, nous vous proposons de reconsidérer l’approche fonctionnelle, de la théorie à sa pratique.
Préalable
La théorie des systèmes a pris forme par l’intime conviction du biologiste Von Bertalanffy qu’il était possible de dégager les principes explicatifs de l’univers considéré sous l’angle d’un système. Aussi en 1954, en collaboration avec l’écono-miste Kenneth E. Boulding, le physiologiste Ralph Gerard et le biomathématicien Anatol Rapoport, il fonda la Société pour l’Étude des Systèmes Généraux. À travers des disciplines différentes, ces scientifiques cherchèrent à dégager des principes généraux semblables. Selon l’expression de Jean-Louis Le Moigne, ils cherchaient à mettre à jour « une compréhension unitaire du monde ». En 1969, von Bertalanffy publie Théorie générale des systèmes où il présente le fonctionnement des systèmes dans toute leur complexité et dont on peut retenir cette définition :
Un système est un ensemble organisé d’éléments en interaction dans un contexte donné, avec une finalité et en évolution.
Tous les termes de cette formule sont essentiels. Pour Jean-Louis Le Moigne, tout système est à considérer sous 3 pôles : ontologique – ce que l’objet est -, fonctionnel – ce que l’objet fait – et génétique – ce que l’objet devient. À Forsyfa, nous déplions le pôle génétique en deux : le pôle existentiel – comment l’objet évolue – et le pôle transgénérationnel contextuel – la transmission de l’histoire.
Nous pouvons représenter un système par une pyramide. Chacun de ces quatre niveaux constitue un angle de vue singulier sur le système tout en étant relié aux trois autres.
De « la bonne distance »… à une posture professionnelle différenciée
Auteurs :
- Samantha BOSMAN
- Véronique LE MANSEC-PILLIN
Extrait libre d’accès
Cet article est une histoire de rencontres et la rencontre d’histoires. Tout d’abord, celle entre chacune de nous, autrices et professionnels de la relation d’aide médico-sociale. C’est avec intérêt que nous les avons accompagnés dans leurs questionnements sur leurs positionnements professionnels. Ensuite, il y a eu notre rencontre, celle de Véronique et Samantha, facilitée par Béatrice (directrice de Forsyfa de 2008 à 2021) qui connaissait et partageait notre intérêt commun pour la question de la distance relationnelle. Dans cet intérêt commun se cachait un deuxième point de convergence : notre histoire respective de filles qui nous a appris à grandir dans une famille enchevêtrée tout en cherchant à faire respecter nos besoins individuels. Car c’est une vraie question existentielle, au sens systémique du terme, que d’appartenir tout en étant différencié, et un long cheminement aussi… Par prolongement, c’est une question éthique que de porter attention à ce niveau de différenciation dans les relations d’accompagnement. Les rencontres se sont poursuivies avec les professionnels que nous souhaitons remercier ici. C’est courageux, en effet, de parler de soi dans l’accompagnement plutôt que de parler des familles. C’est courageux d’être à l’écoute de soi, d’accueillir ce qui se passe corporellement et émotionnellement, dans ces points d’intersections entre nos histoires et celles des personnes accompagnées, pour en faire des leviers d’intervention. Si certains professionnels nous ont parlé de « bonne distance » et d’autres de « juste proximité », nous souhaitons proposer, à l’issue de ce cheminement avec elles et eux, celle de posture professionnelle ajustée au regard d’un contexte.
Le champ de la médecine s’est beaucoup intéressé à la relation soignant/soigné et à la relation thérapeutique plus globalement, incluant immanquablement la notion de distance professionnelle. Cette question traverse le temps car dès l’Antiquité, Hippocrate – celui-là même qui a donné son nom au serment qui inspire éthiquement nos médecins d’aujourd’hui – rappelle qu’il faut prêter une attention particulière à la manière de s’adresser aux malades et de s’asseoir en face d’eux. Il va jusqu’à préconiser l’utilisation de sièges à hauteur égale afin que médecin et patient soient au même niveau. Nous entrevoyons là déjà la préoccupation d’Hippocrate de l’utilisation de l’espace (position et symétrie) au service de la relation de soin (Geadah, 2012).
Depuis Hippocrate, de nombreux praticiens se sont emparés de cette question qui est encore très actuelle et dont il ne s’agira pas, dans cet article, de faire une revue de littérature. Il ne sera pas question non plus de faire un catalogue des bonnes pratiques. Nous souhaitons proposer ici une réflexion sur la posture professionnelle, et ce dans une perspective systémique. Nous allons donc nous intéresser à la relation d’accompagnement plus généralement, que celle-ci soit médicale ou sociale.
À la relation d’aide, nous préférerons le terme de relation d’accompagnement. La relation d’aide pourrait en effet amener à s’attacher à l’aide plus qu’à la relation, l’aide relevant alors du contenu, entendu généralement au sens d’une compétence technique. Dans cette posture de l’aide, nous pourrions entrevoir le risque de « faire à la place ». L’intervenant, alors expert en solution, viendrait se substituer à la personne accompagnée.
Approche systémique : histoires d’une émergence
Auteurs :
- Damien Légère
- Jean-Luc Bay
Extrait libre d’accès
Il est particulièrement difficile et complexe de parler de l’émergence de la pensée systémique dans l’histoire des idées. C’est un processus en soi qui est indissociable des histoires des femmes et des hommes, de leurs contextes de vie et de leurs rencontres. Ce mouvement de pensée s’est également nourri de l’histoire des sciences dures (mathématiques, physique, chimie, ingénierie, biologie et écologie scientifique) et des sciences humaines (psychologie, sociologie, philosophie, anthropologie, linguistique). Différents éléments furent en interaction dans un contexte pour faire émerger l’approche systémique.
Le parti pris des auteurs est de dérouler l’histoire de cette émergence au travers d’un accompagnement fictif du génogramme du petit-fils imaginaire de Gregory Bateson, prénommé Martin. Il est aussi prêté aux différents chercheurs évoqués dans cette histoire, des états d’âme inventés. Il en résulte un récit – que nous espérons dynamique, peut-être amusant – qui permet d’appréhender plus facilement la construction de la pensée systémique.
Cet article ne témoigne aucunement de l’accompagnement processuel du génogramme tel que le pensent et le font vivre les intervenants de Forsyfa. En effet, dans cette description, les faits exposés, le contenu, prennent plus de place que la mise au travail de Martin. Dans un processus de génogramme ordinaire, la clarification et la redéfinition des relations entre la personne et son environnement familial, la reconstruction de son histoire inter et transgénérationnelle, sont primordiales pour permettre la différenciation.
Au travers des phrases mises en exergue, nous avons choisi de faire apparaître de grands principes cliniques qui guident la pratique des intervenants systémiques.
Les gens ne veulent pas de travail, de l’argent leur suffirait
Coluche (Philosophe éclairé)
Première partie : métalogue1
Nantes, septembre 2021
Martin : Heu… excusez-moi, mais je ne suis pas très à l’aise, j’angoisse un peu dans cette petite pièce.
Thérapeute : Ah, voulez-vous choisir une autre place qui serait plus confortable ?
Martin : (après hésitation) Oui je veux bien (il se déplace près de la fenêtre). Je peux ouvrir un peu s’il vous plaît ?
Thérapeute : Je vous en prie, faites…
Martin : Merci. Ça va aller… (il s’assoit et se détend un peu)
Thérapeute : Alors Martin, qu’est-ce qui fait qu’on se rencontre ?
Martin : Euh, c’est compliqué en ce moment. J’angoisse, je ne sais plus trop où j’en suis, ce que je veux faire dans la vie, mon métier… J’ai le sentiment de ne pas être à ma place, pas qualifié, pas à la hauteur. Si cela ne vous dérange pas, je vais enregistrer notre rencontre. Peut-être en aurai-je besoin ?
Thérapeute : Je n’y vois pas d’inconvénients.
Martin est un jeune homme de 32 ans d’origine anglaise venu en France pour ses études post-doctorales. Aux prises avec un mal-être existentiel qui le ronge depuis quelque temps, il s’interroge… À la fin de ses études scientifiques en bio-informatique – et afin d’obtenir un poste de chercheur dans une unité de génomique de l’Inserm –, il doit présenter un projet de recherche. Les semaines se passent, il ne parvient pas à rédiger la moindre ligne. Souvent, il a l’impression d’être un usurpateur reprenant les idées des autres chercheurs, tandis qu’à d’autres moments et de façon contraire, il est tétanisé qu’un collègue lui vole ses idées. Cette oppression intellectuelle est accompagnée d’une peur de plus en plus gênante de se trouver dans des espaces clos.
1/ « Un métalogue, explique G. Bateson, est une sorte de conversation dans laquelle la structure du dialogue
éclaire le problème traité tout autant que le contenu des messages » (cela signifie que l’histoire est une construction).
Exploration d’une tâche non réalisée :
La fonction systémique des prescriptions
Auteurs :
- Damien Légère
- Béatrice BOUSSARD
Extrait libre d’accès
Cet article est issu d’une présentation au Congrès de l’EFTA (Association européenne de thérapie familiale), à Ljubljana (Slovénie), en septembre 2022. Cette intervention proposait un documentaire vidéo composé d’une alternance de séquences de thérapie conjugale et de séquences d’échanges entre les deux thérapeutes. Tous ces échanges sont filmés. L’article proposé ici en est la retranscription.
Deux constructions épistémologiques fondent en systémie, la prescription des tâches à la fin d’une rencontre. D’une part, le changement dans une relation d’accompagnement est avant tout émotionnel et relationnel ; il ne relève pas uniquement de la prise de conscience. D’autre part, il n’y a pas d’entretien non directif car l’intervenant ne peut être neutre. Son attitude – même silencieuse – viendra influencer la réponse du système1. Aussi, Jay Haley et Mara Selvini ont été les premiers à mettre en valeur ces deux fondamentaux. L’approche systémique a connu une révolution avec la seconde cybernétique : il n’y a pas d’extériorité à un système. Plus que d’influencer le système reçu, l’intervenant participe au fonctionnement du système. Aussi, à l’aube du XXIe siècle, nous sommes amenés à nous interroger : comment concevoir une tâche dans un processus d’intervention systémique de 2nde cybernétique ?Qu’est-ce qu’une tâche dans une intervention systémique ? Dans un premier temps, il est plus aisé de nommer ce que n’est pas une prescription de tâche : pas une réponse à une demande, pas une solution apportée à un problème, pas un conseil pour changer d’attitude, ni une façon de valoriser l’expertise de l’intervenant. À partir de notre expérience clinique, nous concevons qu’une prescription de tâche est avant tout la proposition d’une nouvelle expérience émotionnelle et relationnelle. Même si cela peut surprendre, la réalisation de la tâche n’a pas de valeur en tant que telle. En effet, tout d’abord, dès que la prescription est énoncée, elle met au travail le système qui active son organisation et son fonctionnement pour la réaliser, ou pour l’effectuer différemment, partiellement ou pour continuer à faire la même chose. La fonction d’une prescription est de « densifier », « surligner » les relations au sein de l’organisation du système. Et c’est déjà commencer à changer les règles du jeu relationnel, même si c’est juste en les identifiant. La prescription d’une tâche n’est pas extérieure à l’intervention, elle est en soi une intervention qui révèle et active le fonctionnement du système.